UNE CONVERSATION AVEC EDITH SOOCKINDT, 12 JUILLET 2016 (http://tinyurl.com/j4g72kf).
 Françoise Brun est une des grandes traductrices de l’italien et c’est plus de 130 œuvres traduites qui jalonnent sa carrière, de Baricco à Loy en passant par Agus et Sorrentino. Signe de ce labeur soutenu au fil des ans, elle a reçu en 2011 à l’unanimité le Grand Prix de Traduction de la Société des Gens de Lettres, une belle récompense pour le travail d’une vie.
Françoise Brun est une des grandes traductrices de l’italien et c’est plus de 130 œuvres traduites qui jalonnent sa carrière, de Baricco à Loy en passant par Agus et Sorrentino. Signe de ce labeur soutenu au fil des ans, elle a reçu en 2011 à l’unanimité le Grand Prix de Traduction de la Société des Gens de Lettres, une belle récompense pour le travail d’une vie.
Curieuse d’en apprendre davantage, je l’ai donc soumise au feu brûlant de mes questions…
L’interview est longue et dense, mais passionnante !
Françoise, la carrière de traductrice littéraire était-elle celle que vous aviez choisie lorsque vous vous êtes lancée dans des études de lettres modernes (romanes pour les Belges) et d’italien ? Je crois savoir que non… Pourquoi cette bifurcation ?
Quand j’ai entrepris des études littéraires, c’était par goût. Depuis longtemps la littérature, la langue, l’écriture, le style étaient ce qui me passionnait. Le seul avenir professionnel possible me paraissait alors l’enseignement. Par conformisme familial, sans doute, parents profs, oncle, tante, grands-parents et arrière grands-parents « hussards de la République »… Je n’imaginais qu’un métier-prétexte et une vie consacrée à l’écriture sous toutes ses formes. Les expériences d’enseignement que j’ai faites ensuite m’ont amusée quand il s’agissait de remplacements courts, mais ennuyée et déprimée quand c’est devenu du plus long terme. J’ai toujours eu du mal avec les cadres, les horaires, les relations avec les collègues : ce n’était pas mon monde, c’était celui de mes parents, celui dont je voulais m’échapper.
 Et puis, à 25 ans, le hasard : à Venise, une amie française qui arrondissai ses fins de mois en traduisant des articles d’historiens de l’architecture (Venise était alors un pôle dans ce domaine de la recherche) me demande mon aide pour la traduction d’un article. L’auteur était Manfredo Tafuri, le plus difficile d’entre eux. J’accepte, par amitié. Après tout, j’avais aussi une licence d’italien.
Et puis, à 25 ans, le hasard : à Venise, une amie française qui arrondissai ses fins de mois en traduisant des articles d’historiens de l’architecture (Venise était alors un pôle dans ce domaine de la recherche) me demande mon aide pour la traduction d’un article. L’auteur était Manfredo Tafuri, le plus difficile d’entre eux. J’accepte, par amitié. Après tout, j’avais aussi une licence d’italien.
Je revois la table où j’ai travaillé, la lumière de l’après-midi, ma joie. Quelque chose me portait, me soulevait de terre. J’ai compris que traduire pour des gens n’avait rien à voir avec l’exercice de la version telle qu’on la pratique scolairement, qu’il y avait une dimension supplémentaire : faire passer dans sa propre langue les idées et la parole d’un autre. Faire que de l’autre côté des Alpes sa pensée existe aussi. Cette dimension de « passeur », devenue aujourd’hui un cliché, je ne l’avais jamais imaginée. Je traduisais pour des gens, inconnus de moi mais qui, grâce à ce travail solitaire, à ce face-à-face avec un texte et la petite machine à écrire rouge Valentina de mon amie, connaîtraient la pensée de Manfredo Tafuri en lisant non pas un essai sur lui mais sa pensée, directement.
Cet après-midi a été certainement le plus important de mon existence : le bonheur ressenti, la sensation d’être enfin à ma place et d’y être utile m’ont transportée. J’ai pensé : si je peux faire ça toute ma vie, à la fin j’aurai eu une belle vie. Ça n’avait guère de sens concret car à l’époque, les métiers de la traduction n’étaient pas ce qu’ils sont devenus : on n’en parlait jamais, il n’y avait pas de statut du traducteur et on n’enseignait pas la traduction à l’université. Je ne savais pas si c’était un métier, mais j’ai décidé que c’en serait un et que je ferais tout pour en vivre.
 Une année plus tard, un éditeur français me demandait de traduire un livre entier de Manfredo Tafuri, puis un autre me demandait de traduire un autre très grand nom de l’architecture, Aldo Rossi. Les livres ensuite se sont enchaînés, toujours dans ce domaine de l’histoire de l’art et de l’architecture, parce que je ne me sentais pas prête pour traduire de la littérature. J’écrivais déjà à l’époque, et je craignais, traduisant de la littérature, de plaquer mon écriture sur celle des autres, de déformer l’écriture de l’autre pour coller la mienne à la place.
Une année plus tard, un éditeur français me demandait de traduire un livre entier de Manfredo Tafuri, puis un autre me demandait de traduire un autre très grand nom de l’architecture, Aldo Rossi. Les livres ensuite se sont enchaînés, toujours dans ce domaine de l’histoire de l’art et de l’architecture, parce que je ne me sentais pas prête pour traduire de la littérature. J’écrivais déjà à l’époque, et je craignais, traduisant de la littérature, de plaquer mon écriture sur celle des autres, de déformer l’écriture de l’autre pour coller la mienne à la place.
Le « saut » dans la littérature, je l’ai fait dix ans plus tard, quand je me suis sentie prête.
Avez-vous réussi à gagner votre vie grâce à cette seule traduction, et quel bilan dressez-vous maintenant que vous êtes en fin de carrière (si tant est qu’un traducteur littéraire prenne jamais sa retraite) ?
Non, certainement pas. Je ne traduisais pas assez pour gagner vraiment de quoi vivre et j’ai fait toute sorte de petits boulots, secrétariat, serveuse de bar ou de restaurant, livreuse de journaux… ce fut une période difficile, où j’essayais de ne pas perdre de vue mon objectif : apprendre à écrire. L’avantage de la traduction d’architecture, c’est qu’elle était à l’époque considérée comme traduction « spécialisée », donc nettement mieux payée que la traduction de littérature.
 Quand j’ai décidé de faire du littéraire, je gagnais un peu moins au feuillet mais je travaillais plus, ce qui compensait. Et en quatre ou cinq ans j’ai pu en vivre correctement. Sauf que très vite je n’ai plus eu de temps ni de disponibilité mentale pour écrire comme avant… C’est un douloureux dilemme : traduire ET écrire est devenu traduire OU écrire. Les deux simultanément, ça m’est en général impossible.
Quand j’ai décidé de faire du littéraire, je gagnais un peu moins au feuillet mais je travaillais plus, ce qui compensait. Et en quatre ou cinq ans j’ai pu en vivre correctement. Sauf que très vite je n’ai plus eu de temps ni de disponibilité mentale pour écrire comme avant… C’est un douloureux dilemme : traduire ET écrire est devenu traduire OU écrire. Les deux simultanément, ça m’est en général impossible.
Quant à la retraite, je n’y pense pas. Je me vois traduire jusqu’à mon dernier souffle, comme écrire. C’est ma vie. Il n’y a pas de retraite de la vie.
Avez-vous observé une évolution (bonne ou mauvaise) du métier au fil des ans ? En anglais, par exemple, les conditions de travail se sont fortement détériorées et les rémunérations patinent.
 Si l’on pense que j’ai commencé au milieu des années 70, je crois qu’on peut parler d’une nette amélioration. Cette profession alors n’était ni codifiée ni reconnue. J’ai eu la chance de commencer au moment où commençaient aussi les luttes des traducteurs pour une meilleure visibilité : il y a eu l’ATLF, il y a eu les Assises d’Arles que nous avons fondées avec ATLAS, puis, dans les années Mitterrand s’est faite une ouverture extraordinaire avec l’arrivée alors de Jean Gattégno au Centre National du Livre. Peu à peu notre profession est devenue visible, peu à peu les éditeurs ont appris à compter avec nous et commencé à mieux respecter la profession. C’est le résultat d’une lutte acharnée des traducteurs, qui a correspondu à une prise de conscience dans le public. Cette lutte-là ne s’arrêtera jamais, dernièrement nous avons eu encore de grandes avancées, sur la reddition des comptes, sur la rédaction d’un nouveau Code des Usages co-signé avec le Syndicat national de l’édition.
Si l’on pense que j’ai commencé au milieu des années 70, je crois qu’on peut parler d’une nette amélioration. Cette profession alors n’était ni codifiée ni reconnue. J’ai eu la chance de commencer au moment où commençaient aussi les luttes des traducteurs pour une meilleure visibilité : il y a eu l’ATLF, il y a eu les Assises d’Arles que nous avons fondées avec ATLAS, puis, dans les années Mitterrand s’est faite une ouverture extraordinaire avec l’arrivée alors de Jean Gattégno au Centre National du Livre. Peu à peu notre profession est devenue visible, peu à peu les éditeurs ont appris à compter avec nous et commencé à mieux respecter la profession. C’est le résultat d’une lutte acharnée des traducteurs, qui a correspondu à une prise de conscience dans le public. Cette lutte-là ne s’arrêtera jamais, dernièrement nous avons eu encore de grandes avancées, sur la reddition des comptes, sur la rédaction d’un nouveau Code des Usages co-signé avec le Syndicat national de l’édition.
Mais il est vrai que sur le plan des rémunérations les avancées ne se sont pas faites. Je gagne moins aujourd’hui au feuillet qu’il y a dix ans, et je ne pense pas être la seule. Le monde de l’édition aussi a bien changé en trente-quarante ans. Certains disent que l’édition d’autrefois est morte. J’avoue le penser souvent.
Pourriez-vous nous décrire une journée type lorsque vous traduisez ?
 Il n’y en a pas. Je traduis en apnée. Autrefois, je travaillais la nuit, parce que j’ai toujours aimé vivre la nuit. Maintenant, les choses se sont inversées et la nuit, je dors. C’est une chose nouvelle, je ne sais pas combien de temps cela durera.
Il n’y en a pas. Je traduis en apnée. Autrefois, je travaillais la nuit, parce que j’ai toujours aimé vivre la nuit. Maintenant, les choses se sont inversées et la nuit, je dors. C’est une chose nouvelle, je ne sais pas combien de temps cela durera.
Mais jour ou nuit, je travaille huit à dix heures par jour, comme en ce moment. Il y a des jours, parfois plusieurs d’affilée, où je ne travaille pas, et ce sont comme des vacances, quand je parviens à les prendre comme telles et non à culpabiliser de ne pas traduire. Parallèlement, en vacances, j’emporte toujours ma traduction. Donc on pourrait dire que je traduis tout le temps, quand je le peux.
J’ai lu dans d’autres interviews que vous pratiquiez la méthode des codes couleurs, effectivement fort efficace. Mais que se passe-t-il ensuite ? Combien de fois relisez/retravaillez-vous un texte, par exemple ? Avez-vous le temps de laisser décanter avant l’envoi à l’éditeur ?
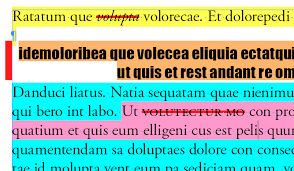 Oui, je surligne en rose ce qui est une grosse difficulté dont je sais que je ne pourrai la résoudre qu’avec le temps, ou en faisant appel à l’auteur, ou à quelqu’un d’autre : généralement ces difficultés ne se résolvent qu’à la discussion avec l’éditeur… ou pas, ou mal. En jaune, je surligne les difficultés mineures, que je sais pouvoir résoudre, ou que j’ai résolues mais qui peuvent être résolues de meilleure façon. Et je surligne en vert ce que j’ai été obligée de changer, soit dans la syntaxe, soit dans la nuance. Je reporte ce même code sur le tapuscrit. Cela me permet, à la relecture, la première, celle du lendemain ou de la semaine, les autres, la relecture finale, puis les épreuves, de savoir toujours où j’en suis par rapport au texte d’origine. C’est la fidélité, dans la lettre comme dans l’esprit, que je cherche, déontologiquement. En même temps je note sur l’original les mots qui reviennent d’une page à l’autre, afin de veiller à les traduire autant que faire se peut par le même mot, ce qui n’est pas toujours possible. Mais au moins, je sais quand je m’en suis écartée et pourquoi.
Oui, je surligne en rose ce qui est une grosse difficulté dont je sais que je ne pourrai la résoudre qu’avec le temps, ou en faisant appel à l’auteur, ou à quelqu’un d’autre : généralement ces difficultés ne se résolvent qu’à la discussion avec l’éditeur… ou pas, ou mal. En jaune, je surligne les difficultés mineures, que je sais pouvoir résoudre, ou que j’ai résolues mais qui peuvent être résolues de meilleure façon. Et je surligne en vert ce que j’ai été obligée de changer, soit dans la syntaxe, soit dans la nuance. Je reporte ce même code sur le tapuscrit. Cela me permet, à la relecture, la première, celle du lendemain ou de la semaine, les autres, la relecture finale, puis les épreuves, de savoir toujours où j’en suis par rapport au texte d’origine. C’est la fidélité, dans la lettre comme dans l’esprit, que je cherche, déontologiquement. En même temps je note sur l’original les mots qui reviennent d’une page à l’autre, afin de veiller à les traduire autant que faire se peut par le même mot, ce qui n’est pas toujours possible. Mais au moins, je sais quand je m’en suis écartée et pourquoi.
Quant à la décantation, on manque toujours de temps pour la faire vraiment, et elle se fait parfois seulement entre la remise du texte à l’éditeur et la correction des épreuves. D’ailleurs, il vaut mieux parfois ne pas trop laisser décanter : il m’est arrivé de corriger les épreuves d’un texte une année après l’avoir remis, et la quantité de choses que je voulais changer était telle qu’il a fallu faire un jeu supplémentaire d’épreuves… J’ai remarqué aussi souvent qu’entre mon premier jet et le jet définitif il n’y a aucune vraie différence, mais entre-temps je suis passée par dix versions différentes de la même phrase. Autrement dit, je devrais apprendre à me faire un peu plus confiance.
Avez-vous des préceptes de traduction et, pourquoi pas, un modèle de traduction ?
J’ai un principe en tout cas : le rythme, respecter le rythme. Cela veut dire la syntaxe, mais aussi les sonorités. Dans le passage de l’italien au français, la syntaxe n’est pas toujours facile à respecter : l’italien pratique volontiers l’inversion, en plaçant le complément avant le verbe, ou bien utilise beaucoup le gérondif, dont la valeur verbale active est plus forte, alors qu’en français un gérondif plombe une phrase. C’est un truisme de le dire, mais la musique italienne et la musique française n’ont pas les mêmes points d’appui dans la phrase. En français le moteur est le verbe, pas en italien. Une autre difficulté est le nombre considérable d’homophones que nous avons en français, quand l’italien, lui, n’en connaît, je crois, qu’une dizaine. En français, le « non-dupe erre » se dit à peu près pareil que « le nom du Père », comme Lacan aimait à le souligner. Et puis la phrase française est techniquement plus chargée : nous avons besoin des pronoms personnels et des articles définis et indéfinis pour savoir de quoi ou qui on parle, et combien ils ou elles sont. L’italien s’en passe allègrement car la marque du pluriel et du masculin-féminin est déjà dans la terminaison du mot. De même, il n’est pas rare qu’on ait besoin en français d’une proposition relative, là où l’italien s’en passe.
Pour résumer, je me fixe deux objectifs face à une phrase :
 – respecter le rythme, parce que je pense que le rythme est la vraie expression de la vérité d’un auteur, de son authenticité. Le rythme ne ment pas. Et quand il n’y a pas de rythme, il n’y a rien. Juste des mots à la suite les uns des autres. Il faut que la phrase française aille à la bonne vitesse, celle de l’auteur, avec ses accélérations, ses ralentis, ses ellipses, ses non-dits, ses coups d’éclat, ses ambiguïtés.
– respecter le rythme, parce que je pense que le rythme est la vraie expression de la vérité d’un auteur, de son authenticité. Le rythme ne ment pas. Et quand il n’y a pas de rythme, il n’y a rien. Juste des mots à la suite les uns des autres. Il faut que la phrase française aille à la bonne vitesse, celle de l’auteur, avec ses accélérations, ses ralentis, ses ellipses, ses non-dits, ses coups d’éclat, ses ambiguïtés.
– lire à haute voix, ne serait-ce que dans ma tête. À la fois pour écouter le bruit que ça fait, et sa coïncidence ou non avec la phrase de l’auteur. Mais aussi pour éliminer tout doute d’un auditeur sur le sens. C’est la question des homophones. Un jour, j’ai entendu lire à la radio une phrase d’une de mes traductions et j’ai compris d’où elle tirait sa force, cette phrase-là : elle était claire, elle donnait au bon moment l’information nécessaire au lecteur. Ça s’était fait par hasard pour moi, mais depuis je veille attentivement à cela : que ma phrase puisse être entendue et comprise par un auditeur qui n’a pas le texte sous les yeux, plus que par un lecteur.
Quant aux sonorités, j’ai la chance de voir la « couleur » des mots quand je les lis. Les consonnes sont en gris mais les voyelles ont pour moi chacune une couleur bien nette. C’est comme dans le poème « Voyelles » de Rimbaud, sauf que pour moi le A est rouge, le E est bleu, le I est vert, le O est blanc-bleuté et le U est jaune. Il paraît que certaines personnes ressentent la même chose pour les notes de musique. C’est un processus complètement inconscient, peut-être un défaut de mes neurones, mais je m’en sers en traduction, pour « peser » la couleur d’une phrase.
Laquelle de vos traductions préférez-vous (si tant est qu’il soit possible d’effectuer ce genre de choix) et pour quelles raisons ?
C’est à peu près impossible de répondre à une telle question ! D’abord parce que chacune de mes traductions a été, même pour les traductions alimentaires, une aventure en soi, un voyage dans un univers. Comment choisir ? Et puis chacune se rappelle à moi, quand j’y pense, plutôt pour ses erreurs ou ses imperfections ou ses manques que pour ses réussites.
Vous avez traduit des auteurs connus et d’autres qui le sont moins. Lequel aimeriez-vous sortir de l’ombre pour nous aujourd’hui ?
 J’ai une tendresse particulière pour le seul livre que j’aie traduit d’un auteur mort : Le Navigateur du déluge, de Mario Brelich (chez Liana Levi). C’est une réécriture à la fois désopilante et profonde, très « Mitteleuropa », de l’épisode de Noé constructeur de l’Arche. C’est un texte d’une grande finesse et humanité, et j’ai été désolée qu’il passe presque inaperçu (même si j’avais été invitée à en parler pendant une heure sur France Culture à sa parution).
J’ai une tendresse particulière pour le seul livre que j’aie traduit d’un auteur mort : Le Navigateur du déluge, de Mario Brelich (chez Liana Levi). C’est une réécriture à la fois désopilante et profonde, très « Mitteleuropa », de l’épisode de Noé constructeur de l’Arche. C’est un texte d’une grande finesse et humanité, et j’ai été désolée qu’il passe presque inaperçu (même si j’avais été invitée à en parler pendant une heure sur France Culture à sa parution).
Vous êtes « la » traductrice de Baricco, si je ne m’abuse. Quelles difficultés particulières y a-t-il à traduire ses livres ? J’avoue avoir été émerveillée par votre traduction de Soie, au point que j’ai peu lu d’autres livres de lui, de peur qu’il ne me déçoive…
 Je ne suis pas « la » traductrice de Baricco, il y en a eu et il y en aura d’autres. Je suis seulement la première, la traductrice historique, je dirais. Lorsque son premier roman, Castelli di rabbia (Châteaux de la colère en français), est sorti, en 1991, j’ai eu comme un électrochoc : cette écriture était exactement celle que j’attendais, d’une certaine façon. Cette inventivité, cette jubilation. Et j’ai pensé tout de suite que si moi, je l’attendais, d’autres l’attendaient forcément aussi. J’ai eu la certitude que ce livre, cet auteur marcheraient, rencontreraient un vaste public. Pendant longtemps j’ai été la seule, avec quelques autres, à y croire. Bien sûr, j’ai cherché un éditeur pour lui en France, mais curieusement personne n’y croyait. Ça a duré trois ans, trois ans pendant lesquels j’ai présenté ce livre (et un deuxième sorti entre-temps) à tous les éditeurs, grands ou petits. Chaque fois ils avaient une bonne raison pour ne pas le prendre… Soit ils avaient déjà un jeune auteur très original à défendre, soit la personne qui s’était enthousiasmée pour le livre était devenue persona non grata au sein de sa propre maison d’édition et je ne le savais pas, soit l’éditeur intéressé s’était mis en faillite, bref, les choses capotaient toujours au dernier moment. Je suis devenue amie au fil du temps avec la responsable italienne des droits étrangers et on travaillait en équipe : j’envoyais mes cinquante premières pages traduites et ma note de lecture à un éditeur, pendant qu’elle, d’Italie, envoyait un exemplaire du livre. On peut dire que toutes les maisons d’édition sur la place de Paris l’ont eu entre les mains. Encore aujourd’hui je me demande pourquoi personne n’y voyait le potentiel de Baricco. C’était la même chose dans les autres pays : longtemps, Baricco n’a eu qu’un seul livre traduit, et c’était son premier roman, traduit très vite, en norvégien, si je me souviens bien. Et puis, un jour, au bout de trois ans il y a eu le miracle : une nouvelle équipe chez Albin Michel, et moi qui, sur une question de Dominique Autrand, parle de Baricco, comme ça, en passant, sans trop y croire. On ne retrouve pas mon dossier, j’en envoie un nouveau. Et c’est l’emballement, tout de suite. Après, ce furent des instants, des années magiques. On a eu le Médicis étranger, une presse dithyrambique, des ventes importantes pour chacun des livres suivants, un best-seller avec Soie.
Je ne suis pas « la » traductrice de Baricco, il y en a eu et il y en aura d’autres. Je suis seulement la première, la traductrice historique, je dirais. Lorsque son premier roman, Castelli di rabbia (Châteaux de la colère en français), est sorti, en 1991, j’ai eu comme un électrochoc : cette écriture était exactement celle que j’attendais, d’une certaine façon. Cette inventivité, cette jubilation. Et j’ai pensé tout de suite que si moi, je l’attendais, d’autres l’attendaient forcément aussi. J’ai eu la certitude que ce livre, cet auteur marcheraient, rencontreraient un vaste public. Pendant longtemps j’ai été la seule, avec quelques autres, à y croire. Bien sûr, j’ai cherché un éditeur pour lui en France, mais curieusement personne n’y croyait. Ça a duré trois ans, trois ans pendant lesquels j’ai présenté ce livre (et un deuxième sorti entre-temps) à tous les éditeurs, grands ou petits. Chaque fois ils avaient une bonne raison pour ne pas le prendre… Soit ils avaient déjà un jeune auteur très original à défendre, soit la personne qui s’était enthousiasmée pour le livre était devenue persona non grata au sein de sa propre maison d’édition et je ne le savais pas, soit l’éditeur intéressé s’était mis en faillite, bref, les choses capotaient toujours au dernier moment. Je suis devenue amie au fil du temps avec la responsable italienne des droits étrangers et on travaillait en équipe : j’envoyais mes cinquante premières pages traduites et ma note de lecture à un éditeur, pendant qu’elle, d’Italie, envoyait un exemplaire du livre. On peut dire que toutes les maisons d’édition sur la place de Paris l’ont eu entre les mains. Encore aujourd’hui je me demande pourquoi personne n’y voyait le potentiel de Baricco. C’était la même chose dans les autres pays : longtemps, Baricco n’a eu qu’un seul livre traduit, et c’était son premier roman, traduit très vite, en norvégien, si je me souviens bien. Et puis, un jour, au bout de trois ans il y a eu le miracle : une nouvelle équipe chez Albin Michel, et moi qui, sur une question de Dominique Autrand, parle de Baricco, comme ça, en passant, sans trop y croire. On ne retrouve pas mon dossier, j’en envoie un nouveau. Et c’est l’emballement, tout de suite. Après, ce furent des instants, des années magiques. On a eu le Médicis étranger, une presse dithyrambique, des ventes importantes pour chacun des livres suivants, un best-seller avec Soie.
Quant à la difficulté de traduire Baricco, elle est grande mais pas insurmontable. Quand l’auteur est un virtuose, il en reste toujours un peu quelque chose dans sa traduction. Baricco écrit comme on compose de la musique. C’est la clé pour le traduire, à mon avis.
Vous êtes également la traductrice (pour trois ouvrages) de la délicieuse et délicate Milena Agus que j’aime tout particulièrement, en tout cas dans ses premiers livres. Etes-vous parvenue à percer le secret de son écriture ? Le charme (simple, si simple en apparence) de sa petite musique tient à quoi ?
 Parvenir à percer le secret d’une écriture, c’est ce que nous devons faire quand nous traduisons. Mais nous le faisons en traduisant, c’est une révélation qui se fait in fieri, ce n’est pas quelque chose sur quoi on peut, dans l’après-coup, mettre des mots. Peut-être d’ailleurs n’est-ce pas souhaitable. Le rapport que nous avons aux textes, aux auteurs, n’est pas le même que celui des spécialistes d’un auteur. Traduire est l’inverse du commentaire de texte. Victor Hugo disait : « Le commentaire couche Shakespeare sur la table d’autopsie, la traduction le remet debout ». On peut peut-être aller du commentaire à la traduction, mais commenter un écrivain qu’on a traduit, c’est pour moi mission presque impossible.
Parvenir à percer le secret d’une écriture, c’est ce que nous devons faire quand nous traduisons. Mais nous le faisons en traduisant, c’est une révélation qui se fait in fieri, ce n’est pas quelque chose sur quoi on peut, dans l’après-coup, mettre des mots. Peut-être d’ailleurs n’est-ce pas souhaitable. Le rapport que nous avons aux textes, aux auteurs, n’est pas le même que celui des spécialistes d’un auteur. Traduire est l’inverse du commentaire de texte. Victor Hugo disait : « Le commentaire couche Shakespeare sur la table d’autopsie, la traduction le remet debout ». On peut peut-être aller du commentaire à la traduction, mais commenter un écrivain qu’on a traduit, c’est pour moi mission presque impossible.
 Ce que je peux dire, c’est ce que j’ai ressenti à traduire Milena Agus, la particularité de son regard, qui fait celle de son écriture pour moi : une innocence absolue, étonnante chez un écrivain qui vient d’une culture chrétienne. Un regard sur le monde qui est comme à l’éternel présent, l’éternité du moment de la découverte. Cela donne à ses romans quelque chose de poignant parce qu’on ne sait jamais ce que les personnages vont faire, ce dont ils sont capables. Folie et raison y sont sur le même plan, deux composantes du monde. Et cela donne à l’érotisme qui est le fil rouge de beaucoup de ses textes un goût inexplicable : il n’y a pas de péché chez elle, pas de remords, pas de culpabilité. Voilà, c’est un monde d’avant la faute. Même le masochisme n’y est pas coupable. Un regard d’enfance éternelle, peut-être ? Je ne peux guère en dire plus, je n’en sais pas plus.
Ce que je peux dire, c’est ce que j’ai ressenti à traduire Milena Agus, la particularité de son regard, qui fait celle de son écriture pour moi : une innocence absolue, étonnante chez un écrivain qui vient d’une culture chrétienne. Un regard sur le monde qui est comme à l’éternel présent, l’éternité du moment de la découverte. Cela donne à ses romans quelque chose de poignant parce qu’on ne sait jamais ce que les personnages vont faire, ce dont ils sont capables. Folie et raison y sont sur le même plan, deux composantes du monde. Et cela donne à l’érotisme qui est le fil rouge de beaucoup de ses textes un goût inexplicable : il n’y a pas de péché chez elle, pas de remords, pas de culpabilité. Voilà, c’est un monde d’avant la faute. Même le masochisme n’y est pas coupable. Un regard d’enfance éternelle, peut-être ? Je ne peux guère en dire plus, je n’en sais pas plus.
Vous êtes également la traductrice d’un roman (D’acier, de Silvia Avallone) qui a connu un joli succès (Grand Prix des Lecteurs de l’Express) que je ne m’explique pas tant je n’ai pas éprouvé la moindre envie de lire ce livre, un avis qui n’engage que moi bien sûr. Pourriez-vous me donner trois bonnes raisons de changer d’idée ?
Je ne sais pas si j’en trouverai trois, mais déjà une, et elle est de taille : Silvia Avallone est une romancière, une vraie. Les romanciers sont bien plus rares qu’on ne croit. Il y a des gens qui écrivent des livres qui nous touchent, nous bouleversent, nous amusent… mais très peu de vrais romanciers. Ce que j’appelle « romancier », c’est l’écrivain capable d’inventer des personnages qu’on n’oublie pas, qui ont une épaisseur de vie, une profondeur et un mystère dont le livre a su nous définir les contours sans les percer. Ils continuent de vivre en nous comme vivent en nous les personnes que nous avons connues dans la vraie vie. Anna et Francesca, les deux héroïnes de D’acier, existent toujours dans ma mémoire cinq ans après la traduction, comme existent Marina et Andrea, les deux protagonistes de son deuxième roman, Marina Bellezza. Comme existent Anna Karénine, Emma Bovary, le prince Mychkine et Nastassia Filippovna. Je ne veux pas dire que Silvia Avallone est le Tolstoï ou le Dostoïevski d’aujourd’hui, elle le deviendra peut-être, elle est si jeune. Mais elle est de cette famille-là. Elle a ce don inné, cette capacité qu’on a ou qu’on n’a pas : la puissance romanesque.
 J’ai traduit un grand nombre de romans, j’ai retrouvé dans mes rêves des phrases, des atmosphères qui étaient dans ces romans, ou bien j’ai rêvé de la maison des Routes de poussière, de Rosetta Loy. Mais je n’ai rêvé que deux fois des personnages : la première fois c’était les deux héros de Melodramma (Partition vénitienne, chez Liana Levi), de Pier Maria Pasinetti, un auteur qu’on devrait redécouvrir, ou découvrir enfin, car il a cette même puissance romanesque. Dans mon rêve, je passais en train et je voyais au loin, dans la plaine du Pô, les deux personnages du roman debout, qui discutaient, habillés de redingotes et chapeaux haut-de-forme, comme dans le roman, qui se passe au XIXe siècle. Je les voyais non tels que l’auteur les avait décrits, car il ne les décrivait pas, mais tels que je me les étais imaginés. Et je les voyais de loin, depuis un train. Or, quand je traduisais D’acier, j’ai rêvé que j’étais dans une des scènes les plus fortes du livre, la scène de la patinoire, et j’étais un des personnages (je ne dirai pas lequel). Cela ne m’était jamais arrivé avant, et cela ne m’est plus arrivé.
J’ai traduit un grand nombre de romans, j’ai retrouvé dans mes rêves des phrases, des atmosphères qui étaient dans ces romans, ou bien j’ai rêvé de la maison des Routes de poussière, de Rosetta Loy. Mais je n’ai rêvé que deux fois des personnages : la première fois c’était les deux héros de Melodramma (Partition vénitienne, chez Liana Levi), de Pier Maria Pasinetti, un auteur qu’on devrait redécouvrir, ou découvrir enfin, car il a cette même puissance romanesque. Dans mon rêve, je passais en train et je voyais au loin, dans la plaine du Pô, les deux personnages du roman debout, qui discutaient, habillés de redingotes et chapeaux haut-de-forme, comme dans le roman, qui se passe au XIXe siècle. Je les voyais non tels que l’auteur les avait décrits, car il ne les décrivait pas, mais tels que je me les étais imaginés. Et je les voyais de loin, depuis un train. Or, quand je traduisais D’acier, j’ai rêvé que j’étais dans une des scènes les plus fortes du livre, la scène de la patinoire, et j’étais un des personnages (je ne dirai pas lequel). Cela ne m’était jamais arrivé avant, et cela ne m’est plus arrivé.
Je ne sais pas ce que fera Silvia Avallone de ce talent énorme qu’elle a, mais j’ai confiance en elle.
Avez vous un livre italien (ou français, après tout) de chevet ?
En italien j’aime définitivement Calvino, tout ce que j’en ai lu mais particulièrement la Trilogie de « Nos Ancêtres » et parmi ceux-là Le Baron perché, auquel certainement je m’identifie. Nous aussi, les traducteurs, comme les écrivains, nous vivons perchés dans notre arbre et n’en descendons jamais, ou pas vraiment.
 En français, j’ai deux livres de chevet, qui sont même plus que des livres de chevet puisque je me débrouille toujours pour les emporter en voyage, et que je ne cesse de les lire et relire : c’est Alcools d’Apollinaire, son recueil de poésie majeur, et Un cœur simple, un des trois contes de Flaubert, que je tiens pour un des chefs-d’œuvre de la langue française. De l’un comme de l’autre je sais des passages par cœur, et chaque lecture m’émeut au même endroit, chaque passage conserve au fil du temps sa capacité à me serrer le cœur ou à me faire monter des larmes d’admiration. Ce sont mes deux talismans : si ces deux livres existent, la vie vaut la peine d’être vécue de la manière dont j’ai choisi de la vivre.
En français, j’ai deux livres de chevet, qui sont même plus que des livres de chevet puisque je me débrouille toujours pour les emporter en voyage, et que je ne cesse de les lire et relire : c’est Alcools d’Apollinaire, son recueil de poésie majeur, et Un cœur simple, un des trois contes de Flaubert, que je tiens pour un des chefs-d’œuvre de la langue française. De l’un comme de l’autre je sais des passages par cœur, et chaque lecture m’émeut au même endroit, chaque passage conserve au fil du temps sa capacité à me serrer le cœur ou à me faire monter des larmes d’admiration. Ce sont mes deux talismans : si ces deux livres existent, la vie vaut la peine d’être vécue de la manière dont j’ai choisi de la vivre.
Et une ville italienne de prédilection ? Pour quelles raisons ?
 Longtemps je n’ai aimé que Venise, je ne pouvais pas aller en Italie sans aller d’abord à Venise. Venise, la seule ville qui n’ait pas déçu le Narrateur dans la Recherche, parce que Venise est un livre, un corps, un univers en soi. « La vraie vie, la vie rêvée », dit Proust. Il ajoute « c’est la littérature ». Mais Venise est la littérature. Pour moi, malgré l’invasion touristique, cela reste « la » ville.
Longtemps je n’ai aimé que Venise, je ne pouvais pas aller en Italie sans aller d’abord à Venise. Venise, la seule ville qui n’ait pas déçu le Narrateur dans la Recherche, parce que Venise est un livre, un corps, un univers en soi. « La vraie vie, la vie rêvée », dit Proust. Il ajoute « c’est la littérature ». Mais Venise est la littérature. Pour moi, malgré l’invasion touristique, cela reste « la » ville.
Qu’est ce qui vous a poussée vers l’apprentissage de cette langue plutôt qu’une autre ?
 J’y suis venue « par défaut », je dirais. J’étais l’aînée, mon père enseignait l’allemand, j’ai donc fait allemand en première langue. Pour la seconde langue on m’a donné le droit de choisir. Et comme je détestais l’allemand (conflits avec mon père), j’ai choisi ce qui m’en semblait le plus éloigné : l’italien. Les cours d’italien étaient délicieux : nous étions peu, et nous baignions, professeurs et élèves, dans une atmosphère de gentillesse et joie de vivre qui est propre à l’italien. Ce furent les moments les plus heureux de ma scolarité. À l’université, même si j’ai choisi Lettres modernes, j’ai poursuivi parallèlement des études d’italien, et je suis allée à Grenoble, qui était la meilleure faculté d’italien en France. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans de l’italien dedans.
J’y suis venue « par défaut », je dirais. J’étais l’aînée, mon père enseignait l’allemand, j’ai donc fait allemand en première langue. Pour la seconde langue on m’a donné le droit de choisir. Et comme je détestais l’allemand (conflits avec mon père), j’ai choisi ce qui m’en semblait le plus éloigné : l’italien. Les cours d’italien étaient délicieux : nous étions peu, et nous baignions, professeurs et élèves, dans une atmosphère de gentillesse et joie de vivre qui est propre à l’italien. Ce furent les moments les plus heureux de ma scolarité. À l’université, même si j’ai choisi Lettres modernes, j’ai poursuivi parallèlement des études d’italien, et je suis allée à Grenoble, qui était la meilleure faculté d’italien en France. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans de l’italien dedans.
L’amour de la traduction est pour vous, j’imagine, indissociable de l’amour que vous portez à ce pays et à cette culture ?
Sans doute. Comme la traduction est pour moi un métier de partage, partager ce que j’aime est la seule chose qui ait du sens…
Le Grand Prix de Traduction de la SGDL a-t-il changé quelque chose dans votre carrière ?
 Oui et non. Sur le moment, ce fut un choc car je ne m’y attendais pas du tout. Quand on débute, on voit des collègues recevoir des prix et on se dit qu’on aimerait un jour réussir assez dans ce métier pour en mériter un. Et puis le temps passe, et on oublie. J’ai eu la chance que certains de mes auteurs aient remporté des prix, et c’était déjà pour moi une reconnaissance, en creux, de mon travail.
Oui et non. Sur le moment, ce fut un choc car je ne m’y attendais pas du tout. Quand on débute, on voit des collègues recevoir des prix et on se dit qu’on aimerait un jour réussir assez dans ce métier pour en mériter un. Et puis le temps passe, et on oublie. J’ai eu la chance que certains de mes auteurs aient remporté des prix, et c’était déjà pour moi une reconnaissance, en creux, de mon travail.
Le Grand Prix de Traduction de la SGDL, lui, couronne l’ensemble d’une œuvre de traducteur : d’abord, il vous fait vous apercevoir que vous avez une œuvre, ce qui fait une impression étrange. On se demande un peu s’il ne faudrait pas, après cela, s’arrêter. Mais bien sûr, on ne peut pas, donc on continue. Le grand plaisir que cela m’a fait a été la reconnaissance sur un point précis, qui est mon orgueil de traductrice. Il m’a été décerné à l’occasion de la parution la même année de deux textes qui n’avaient rien à voir l’un avec l’autre, qui étaient même l’antithèse l’un de l’autre : D’acier, de Silvia Avallone, et Ils ont tous raison, de Paolo Sorrentino. On m’y a donc félicitée de ma capacité à passer d’un univers linguistique à un autre, qui est son contraire. J’ai été très fière de cela car je pense qu’un traducteur doit être un caméléon.
Nous avions fait connaissance au CITL (Arles). Y avez-vous déjà été en résidence ?
 J’y suis allée souvent quand je faisais partie du Conseil d’administration d’Atlas, qui gère les Assises de la Traduction en Arles et le Collège des Traducteurs. J’y ai même passé quelques jours en résidence, en effet, où j’ai pu apprécier le plaisir de travailler dans la bibliothèque et d’avoir à portée de main tous les outils de travail, tous les dictionnaires nécessaires à un traducteur. Je conseille vivement aux jeunes collègues d’y aller en résidence, d’autant qu’il y a une ambiance sympathique. Et puis nous sommes tellement isolés les uns des autres, chacun dans sa bulle, que voir d’autres fous comme nous, d’autres passionnés comme nous de la traduction, fait un bien immense. Pour la même raison, je conseille absolument aux collègues de se rendre aux Assises d’Arles, une fois par an, le week-end du 11 novembre : être au milieu de tous ces gens qui ont attrapé un jour, comme nous, le virus de la traduction, un virus qui vous change la vie, est un grand bonheur, une exaltation qui alimente le moteur intérieur pour de nombreux mois. On y découvre qu’on n’est pas seul, c’est énorme !
J’y suis allée souvent quand je faisais partie du Conseil d’administration d’Atlas, qui gère les Assises de la Traduction en Arles et le Collège des Traducteurs. J’y ai même passé quelques jours en résidence, en effet, où j’ai pu apprécier le plaisir de travailler dans la bibliothèque et d’avoir à portée de main tous les outils de travail, tous les dictionnaires nécessaires à un traducteur. Je conseille vivement aux jeunes collègues d’y aller en résidence, d’autant qu’il y a une ambiance sympathique. Et puis nous sommes tellement isolés les uns des autres, chacun dans sa bulle, que voir d’autres fous comme nous, d’autres passionnés comme nous de la traduction, fait un bien immense. Pour la même raison, je conseille absolument aux collègues de se rendre aux Assises d’Arles, une fois par an, le week-end du 11 novembre : être au milieu de tous ces gens qui ont attrapé un jour, comme nous, le virus de la traduction, un virus qui vous change la vie, est un grand bonheur, une exaltation qui alimente le moteur intérieur pour de nombreux mois. On y découvre qu’on n’est pas seul, c’est énorme !
Arrêterez-vous un jour de traduire ? Pour faire quoi ? Lire, encore, toujours, jardiner, musarder ?
Non, je n’arrêterai jamais. Il faudrait que j’arrête de vivre.